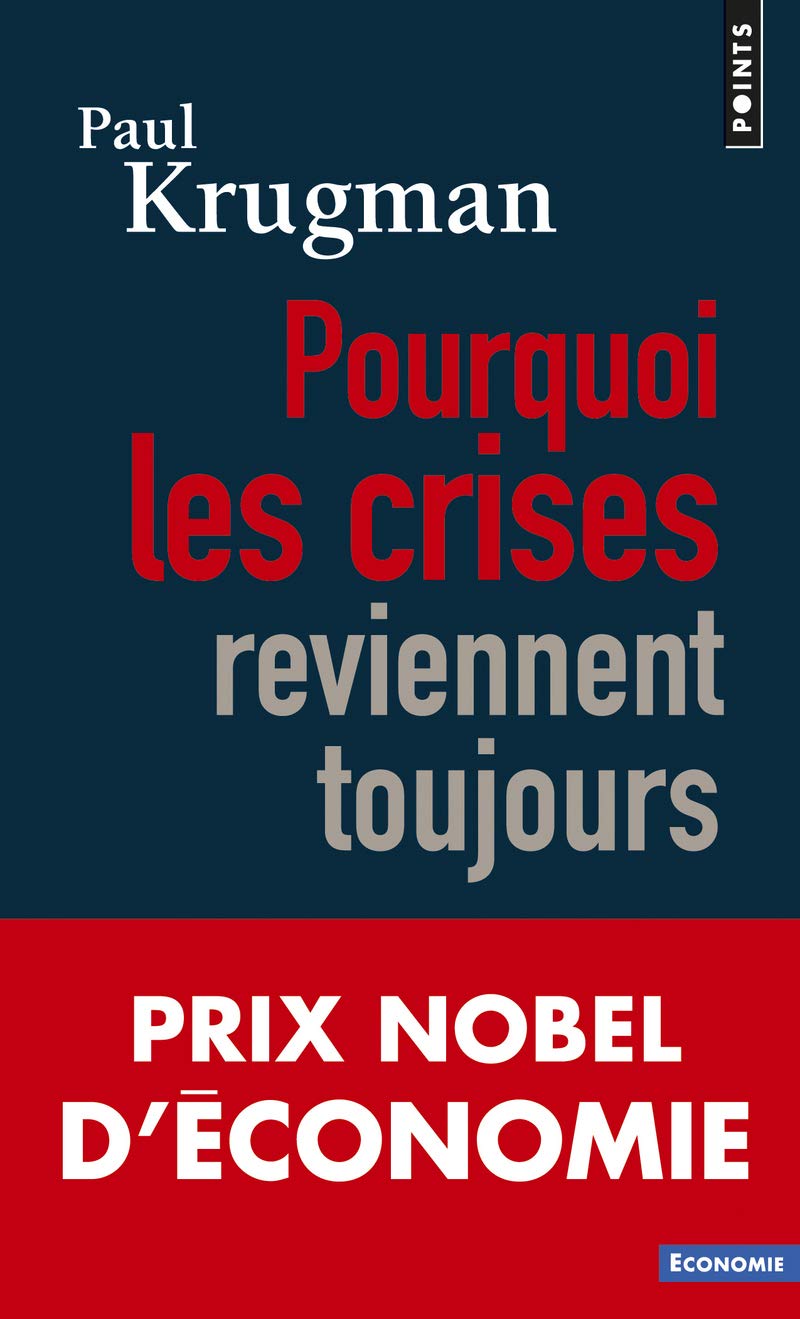• 1/ les crises ayant eu lieu dans différentes parties du Globe auraient dû, au regard de l’inter- connexion croissante des économies nationales via la sphère financière et la globalisation, nous alerter sur l’illusion de la « Grande modération » des années 1980-1990 et la possibilité (l’inéluctabilité?) d’une crise mondialisée. Les masses monétaires manipulées quotidiennement par les acteurs de la finance, notamment le « système financier non bancaire et les fonds spéculatifs, ont rendu le système difficile à corriger en cas de dérapage.
• 2/ les marchés nanciers ont structurellement besoin de régulation, car ils sont épisodi- quement affectés par des dyna- miques auto-réalisatrices que l’auteur quali e de « formes depathologiedumarché».Le mécanisme décrit est celui de la bulle : tout le monde pense que les prix vont monter, donc tout le monde achète, et les prix montent effectivement (cf. lessubprime) puis, selon un schéma inverse, le marché s’effondre : c’est la crise. Or, souligne l’au- teur, ce sont toujours in ne les contribuables qui assument le « risque moral » lors d’une crise : ils paient les pots cassés, pour éviter que tout le système ne s’effondre.
Cette démonstration conduit l’économiste (néo-keynésien) à dénoncer le tournant libéral des politiques économiques (occi- dentales notamment) durant les années 1980 et à prôner une extension de la régulation du système nancier. Sa dénoncia- tion de l’économie de l’offre qu’il quali e de « corpus creux » et de « doctrine fanatique » pourrait le faire passer pour un iconoclaste, et les moins libéraux seront ten- tés de le suivre. Mais sa remise en cause de la politique d’Alan Greenspan (ex-gouverneur de la FED), ou ses allusions aux « manuels d’économie » (les- quels?) dont on ne comprend pas toujours s’il considère qu’ils se trompent ou non, laissent intact l’édi ce théorique de l’éco- nomie standard. Contrairement à P.N. Giraud (2001), P. Jorion (2010) ou A. Orléan (2011) par exemple, qui interrogent, chacun à leur façon, la notion de fon- damental, voire s’attaquent de front à la théorie économique, Paul Krugman reste, malgré son image de rebelle, désespérément standard.
De fait, l’économiste se réfère en permanence aux concepts centraux de ce courant de l’économie dit «néo-clas- sique ». Dès le début du livre, lorsqu’il s’interroge sur la raison de la survenue des récessions, il af rme : « Si vous comprenez et admettez que les marchés par- viennent habituellement à faire coïncider l’offre et la demande –, la vérité est qu’une récession est un phénomène bien particulier ». Une façon, de réduire les crises à des problèmes d’ajustement offre/ demande, donc d’équilibre, tem- poraires. Concepts dont la per- tinence scienti que ne saurait être visiblement discutée par les gens sérieux. Parallèlement aux références explicites à cette loi de l’offre et de la demande : « Or, le marché des changes, à l ’instar des autres marchés, est régi par la loi de l’offre et la demande », les expres- sions employées s’inscrivent régulièrement dans le champ lexi- cal néo-classique, par exemple : « pathologie », « imperfection », «préjugés» et même «lubies» du marché, lequel apparait déci- dément comme un être auto- nome, malgré ses (quelques) défauts. Et lorsqu’il traite d’im- mobilier, l’ouvrage se réfère aux ratios prix/loyers, au retour des prix à leur niveau normal ainsi qu’aux « fondamentaux » : autant de termes issus de l’économie néo-classique. Comprenons-nous bien : que P. Krugman s’inscrive dans le cadre néo-classique n’est pas choquant en soit. Ce qui est gênant, en revanche, c’est qu’il se place à longueur d’ouvrage en hétérodoxe pourfendeur de la pensée économique dominante, dans laquelle il s’inscrit en dé – nitive, puis qu’il fasse croire au lecteur qu’il n’a rien compris s’il n’admet pas d’emblée ce cadre de ré exion. Cette contradiction est d’autant dommage que l’ouvrage n’en reste pas moins, sur le plan des faits rapportés et de l’analyse de leur déroulement, très intéressant.